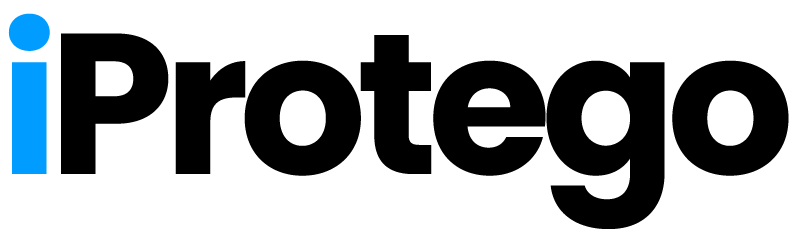Prévention cyber-harcèlement : stratégies et bonnes pratiques La prévention cyber-harcèlement passe par une combinaison d'éducation, de technique et de mobilisation communautaire. Sur le plan éducatif, les programmes scolaires et les campagnes de sensibilisation visent à former les jeunes et leurs familles aux comportements numériques responsables. Ces initiatives incluent des ateliers sur l'empathie en ligne, des […]
Cyber-harcèlement : Actions et Initiatives
Prévention du cyber-harcèlement : stratégies opérationnelles et bonnes pratiques La prévention du cyber-harcèlement nécessite une approche multi-niveaux qui combine éducation, réglementation et outils techniques. Au centre de cette stratégie se trouvent les actions de sensibilisation des jeunes, qui visent à développer des compétences numériques, de l'empathie et des comportements responsables sur Internet. Les établissements scolaires […]
Cyber-harcèlement : Actions et Initiatives
Politiques publiques et dispositifs juridiques pour la lutte contre le cyber-harcèlement La lutte contre le cyber-harcèlement repose d'abord sur un cadre légal et des politiques publiques adaptées à l'ère numérique. Depuis 2020-2025, de nombreux pays ont renforcé leurs lois pour répondre aux formes diversifiées de harcèlement en ligne : insultes répétées, diffusion non consentie d'images, […]