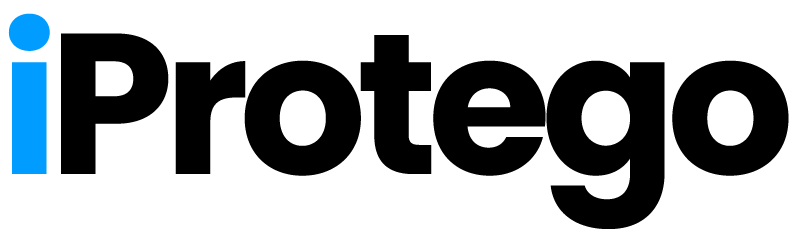Droit numérique et protection des données : obligations et bonnes pratiques Le droit numérique s'impose aujourd'hui comme un pilier incontournable pour toute organisation qui collecte, stocke ou traite des données personnelles. En 2025, la réglementation européenne (RGPD et ses évolutions) et les législations nationales imposent des obligations strictes de transparence, de sécurité et de responsabilité. […]
Le coin du juriste : Conseils pratiques en droit numérique
Comprendre le droit numérique et ses enjeux pour l'e-réputation Le droit numérique désigne l'ensemble des règles juridiques applicables aux activités menées sur Internet et aux technologies de l'information. Il couvre des domaines variés : propriété intellectuelle, responsabilité en ligne, protection des données personnelles, droit de la consommation, et réglementation de l'e-réputation. Pour les personnes physiques […]
Le coin du juriste : Conseils pratiques en droit numérique
Droit numérique : principes essentiels pour les particuliers et les entreprises Le droit numérique recouvre un ensemble de règles juridiques applicables aux activités réalisées en ligne, aux services numériques et au traitement des données personnelles. En 2025, l'importance de ces règles n'a fait que croître, avec des évolutions législatives et jurisprudentielles visant à renforcer la […]