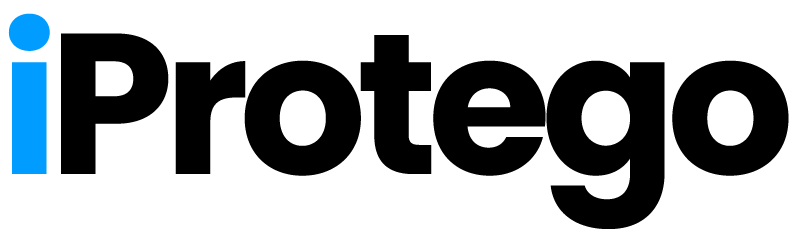Qu’est-ce que le Droit à l’oubli et pourquoi il concerne vos données personnelles Le Droit à l’oubli désigne la possibilité pour une personne de demander la suppression ou la désindexation d’informations la concernant sur Internet afin de limiter l’accès public à des données personnelles qui portent atteinte à sa vie privée ou à sa réputation […]
E-réputation : Études de cas sur l’impact de la gestion des avis clients
Étude de cas 1 — Une PME locale qui a transformé son e-réputation grâce aux avis clients Contexte et enjeux En 2023, une PME française du secteur de la restauration (brasserie de 40 couverts) a fait face à une détérioration progressive de son e-réputation après plusieurs avis clients négatifs sur Google et TripAdvisor. La direction […]
Données personnelles : Comprendre le RGPD et sa conformité pour les entreprises
Qu'est-ce que le RGPD et pourquoi il est essentiel pour les entreprises Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), entré en application en 2018 et toujours au cœur des pratiques en 2025, est le cadre juridique européen qui encadre la collecte, le traitement et la conservation des données personnelles. Pour une entreprise, la […]
Données personnelles : Le droit à l’oubli en question
Qu'est-ce que le droit à l'oubli et comment s'applique-t-il aux données personnelles ? Le droit à l'oubli est devenu un concept central dans la protection des données personnelles et la gestion de la réputation en ligne. Né des évolutions législatives et jurisprudentielles, notamment au sein de l'Union européenne avec le Règlement général sur la protection […]
E-réputation : Études de cas de succès et d’échec
Études de cas de succès : stratégies gagnantes en e-réputation Les exemples positifs d’e-réputation offrent des enseignements concrets pour toute organisation souhaitant renforcer sa marque en ligne. Ces études de cas montrent comment une gestion proactive des avis clients, une communication transparente et des stratégies de contenu cohérentes peuvent transformer une crise potentielle en avantage […]
Données personnelles RGPD & conformité
Comprendre le RGPD et son impact sur les données personnelles Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en application en mai 2018 et reste la référence incontournable pour la protection des données personnelles en Europe et pour les organisations traitant des données de citoyens européens. Comprendre le RGPD, ce n’est pas […]
Cybersécurité : Comprendre le Phishing et les Escroqueries en Ligne
Qu'est-ce que le phishing et comment il évolue en 2025 Le phishing est une technique d'ingénierie sociale visant à tromper une personne pour obtenir des informations sensibles — identifiants, numéros de carte, données personnelles — ou pour l'inciter à installer des logiciels malveillants. Alors que le concept existe depuis des décennies, ses formes se sont […]
E-réputation des Marques : Stratégies pour Gérer l’Image en Ligne
Comprendre l'e-réputation et son impact sur la gestion de l'image de marque L'e-réputation n'est plus un simple indicateur secondaire : elle façonne directement la perception qu'ont les consommateurs d'une marque, influence le parcours d'achat et conditionne la confiance. En 2025, les canaux d'expression se sont multipliés (réseaux sociaux, plateformes d'avis, comparateurs, forums spécialisés, vidéos courtes) […]
E-réputation : Études de cas sur la gestion des avis clients
Étude de cas 1 : Réponse proactive et rétablissement d'une e-réputation locale Contexte et enjeu : Une PME locale du secteur de la restauration voit sa note moyenne chuter après plusieurs avis négatifs liés à un service ponctuel et à une publication virale sur les réseaux sociaux. L'entreprise craint une baisse durable de la fréquentation […]
Cyber-harcèlement : Accompagnement des victimes
Comprendre le cyber-harcèlement et ses impacts pour mieux accompagner les victimes Le cyber-harcèlement désigne l'utilisation des outils numériques — réseaux sociaux, messageries instantanées, plateformes de jeux, forums, applications de partage — pour harceler, intimider, humilier ou menacer une personne. En 2025, l'évolution des technologies (intégration d'IA, contenus éphémères, deepfakes) complexifie la nature des attaques et […]