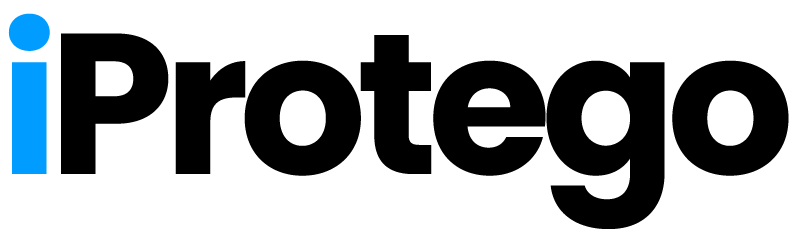Qu’est-ce que le Droit à l’oubli et pourquoi il concerne vos données personnelles Le Droit à l’oubli désigne la possibilité pour une personne de demander la suppression ou la désindexation d’informations la concernant sur Internet afin de limiter l’accès public à des données personnelles qui portent atteinte à sa vie privée ou à sa réputation […]
Cybersécurité : Protéger vos Comptes Personnels
Renforcer l’accès : mots de passe, gestionnaires et authentification multi-facteurs La première barrière pour la protection des comptes personnels réside dans la qualité des informations d’authentification que vous utilisez. En 2025, la cybersécurité exige plus que des mots de passe complexes : elle repose sur une approche combinée de gestion des identifiants et d’authentification multi-facteurs […]
Données personnelles : Le droit à l’oubli en question
Qu'est-ce que le droit à l'oubli et comment s'applique-t-il aux données personnelles ? Le droit à l'oubli est devenu un concept central dans la protection des données personnelles et la gestion de la réputation en ligne. Né des évolutions législatives et jurisprudentielles, notamment au sein de l'Union européenne avec le Règlement général sur la protection […]
E-réputation des Marques : Stratégies pour Gérer l’Image en Ligne
Comprendre l'e-réputation et son impact sur la gestion de l'image de marque L'e-réputation n'est plus un simple indicateur secondaire : elle façonne directement la perception qu'ont les consommateurs d'une marque, influence le parcours d'achat et conditionne la confiance. En 2025, les canaux d'expression se sont multipliés (réseaux sociaux, plateformes d'avis, comparateurs, forums spécialisés, vidéos courtes) […]
Cyber-harcèlement : Actions et Initiatives
Politiques publiques et dispositifs juridiques pour la lutte contre le cyber-harcèlement La lutte contre le cyber-harcèlement repose d'abord sur un cadre légal et des politiques publiques adaptées à l'ère numérique. Depuis 2020-2025, de nombreux pays ont renforcé leurs lois pour répondre aux formes diversifiées de harcèlement en ligne : insultes répétées, diffusion non consentie d'images, […]
Comment sont traitées mes données personnelles avec ChatGPT ?
La gestion des données personnelles avec ChatGPT est devenue une préoccupation majeure alors que l’intelligence artificielle s’intègre de plus en plus dans nos vies quotidiennes. Cet article plonge dans la manière dont ChatGPT traite les données personnelles, en expliquant les politiques de confidentialité, les mesures de sécurité mises en place, et les défis spécifiques liés […]
Comment contacter Google
Contacter Google peut s’avérer essentiel pour résoudre divers problèmes ou obtenir des informations spécifiques sur les services offerts par le géant de la technologie. En tant qu’acteur incontournable du monde numérique, Google propose une multitude de produits et services utilisés quotidiennement par des milliards de personnes. Que ce soit pour des soucis de compte, des […]
Rassembler les informations préliminaires
Rassembler les informations préliminaires constitue une étape fondamentale dans la préparation d’une demande d’audit e-réputation. Cette démarche permet d’assurer que l’agence dispose de toutes les données nécessaires pour mener à bien son analyse. Les entreprises et les individus doivent donc entreprendre un travail de collecte méticuleux, qui englobe non seulement leur présence directe en ligne, […]
Renforcement de la Cybersécurité en Prévision des Jeux Olympiques de Paris
À l’approche des Jeux Olympiques de Paris 2024, la France intensifie ses efforts pour renforcer la cybersécurité et protéger cet événement majeur contre les cybermenaces croissantes. L’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) met en place une série de mesures pour sécuriser les infrastructures critiques et les entreprises associées à cet événement. Identification […]
Agence e-réputation à Bordeaux
Agence iProtego à Bordeaux Notre agence e-réputation à Bordeaux se spécialise dans la gestion de la réputation en ligne, essentielle dans le monde numérique actuel. Que vous soyez une entreprise locale, un entrepreneur individuel, un indépendant ou même un particulier, maintenir une image positive sur internet est crucial. Bordeaux, célèbre pour son vin et son […]