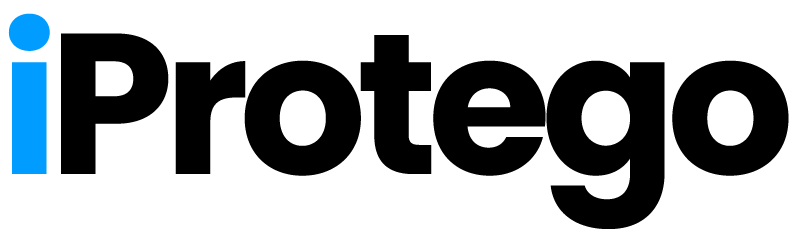Bouclier numérique : Votre image mérite une défense à la hauteur. + de 7 Millions d’internautes protégés.¹ L’offre Bouclier Numérique développée par notre agence iProtego réunit tout ce qu’il faut pour protéger efficacement votre réputation en ligne, qu’il s’agisse de votre identité personnelle ou de celle de votre entreprise sur le web. Grâce à […]
Osculteo
Osculteo : 1ère plateforme de gestion de l’identité numérique Découvrez Osculteo, notre outil phare pour garder le contrôle de votre réputation en ligne. Osculteo est la première plateforme en ligne qui s’adresse aux particuliers pour gérer et maîtriser leur identité numérique et leurs données personnelles. Elle vous permet de garder le contrôle sur votre […]
Cybersécurité : Protégez-vous contre le Phishing et les Escroqueries
Comprendre le phishing et les escroqueries en ligne : modes opératoires et risques Le phishing est une technique d'ingénierie sociale largement utilisée pour dérober des informations sensibles, comme des identifiants, des numéros de carte bancaire ou des données personnelles. En 2025, ces attaques se sont sophistiquées : elles combinent e-mails, SMS (smishing), appels vocaux (vishing), […]
Données personnelles : Droit à l’oubli
Qu'est-ce que le droit à l'oubli et pourquoi il compte pour vos données personnelles Le droit à l'oubli est aujourd'hui un pilier de la protection des données personnelles et de la protection vie privée. Né de la nécessité de permettre aux individus de demander l'effacement des informations les concernant qui sont obsolètes, inexactes ou excessives, […]
Cybersécurité : Protection des comptes
Sécurité des comptes en ligne : bonnes pratiques pour verrouiller vos accès La sécurité des comptes en ligne est devenue un enjeu central pour les particuliers comme pour les entreprises. Chaque compte — messagerie, réseaux sociaux, services bancaires ou plateformes professionnelles — constitue une porte d’entrée potentielle pour des attaques. Comprendre les mécanismes d’attaque (hameçonnage, […]
Cybersécurité : Protéger vos données contre le phishing et les escroqueries
Comprendre le phishing et les escroqueries en ligne Le phishing est une technique d'ingénierie sociale conçue pour tromper les utilisateurs afin d'obtenir des informations sensibles : identifiants, mots de passe, coordonnées bancaires ou données personnelles. Les attaquants imitent souvent des services légitimes (banques, plateformes e‑commerce, réseaux sociaux, services administratifs) via des courriels, SMS, appels téléphoniques […]
Les Meilleurs Outils pour Gérer Votre E-Réputation
Pourquoi choisir des outils de gestion de réputation en 2025 Dans un monde où la visibilité numérique conditionne la confiance des consommateurs, investir dans des outils de gestion de réputation n'est plus accessoire : c'est stratégique. L'e-réputation détermine comment votre marque, votre entreprise ou votre image personnelle est perçue sur les moteurs de recherche, les […]
L’impact des affaires médiatiques sur la réputation des entreprises
Comment les affaires médiatiques fragilisent l'e-réputation des entreprises Les affaires médiatiques constituent aujourd'hui l'une des menaces principales pour l'e-réputation des entreprises. Qu'il s'agisse d'un scandale interne, d'allégations de mauvaise conduite ou d'une fuite de données, la couverture médiatique amplifie chaque événement et accélère sa propagation sur les réseaux sociaux, forums et plateformes d'avis. L'effet multiplicateur […]
Cybersécurité et bonne hygiène numérique
Pourquoi la cybersécurité personnelle est essentielle aujourd'hui À l'ère du tout connecté, la cybersécurité personnelle n'est plus un luxe mais une nécessité. Chaque jour, nous échangeons des informations sensibles — mots de passe, coordonnées bancaires, documents professionnels — via des applications, des réseaux sociaux et des services cloud. Une faille, une négligence ou une mauvaise […]
Cybersécurité : Protégez-vous contre le phishing et les escroqueries en ligne
Comprendre le phishing et les mécanismes des escroqueries en ligne Le phishing est l’une des menaces les plus répandues en matière de cybersécurité en 2025. Dérivé de l’anglicisme « fishing », il consiste à attirer une victime pour lui soutirer des informations sensibles (identifiants, numéros de carte, données personnelles) via des messages frauduleux qui imitent […]